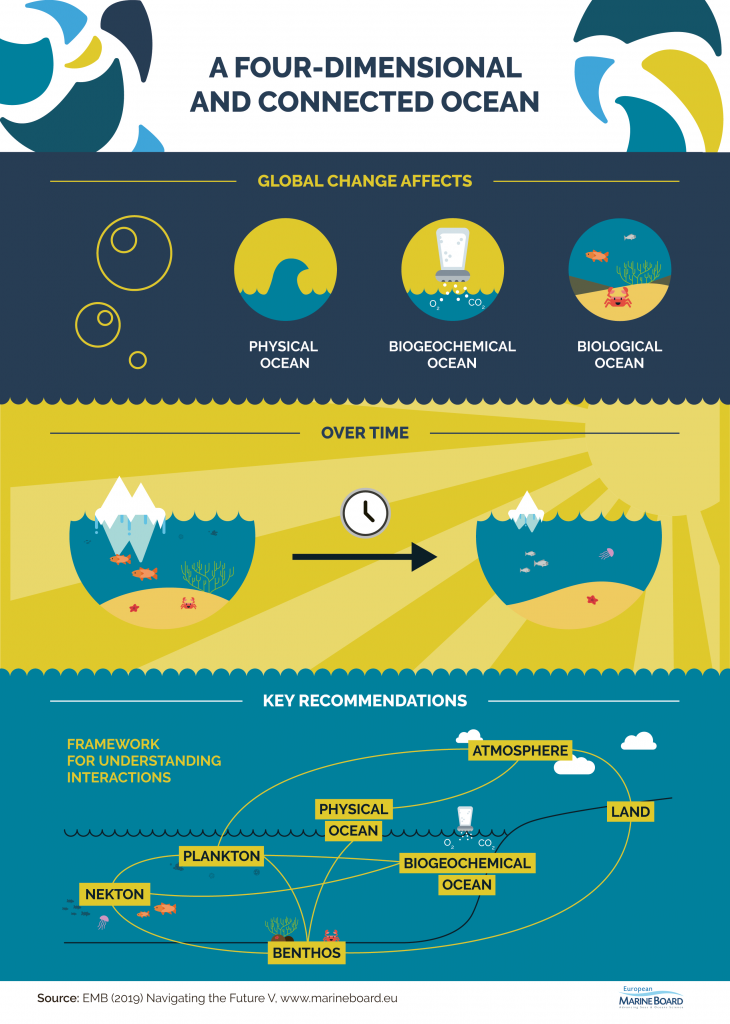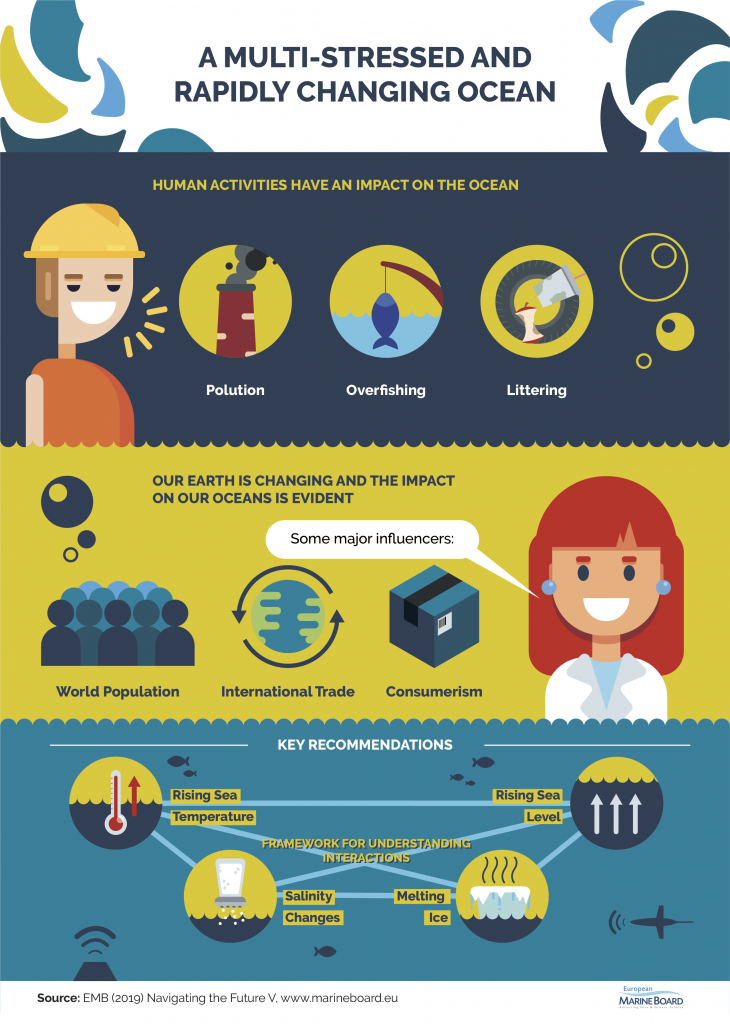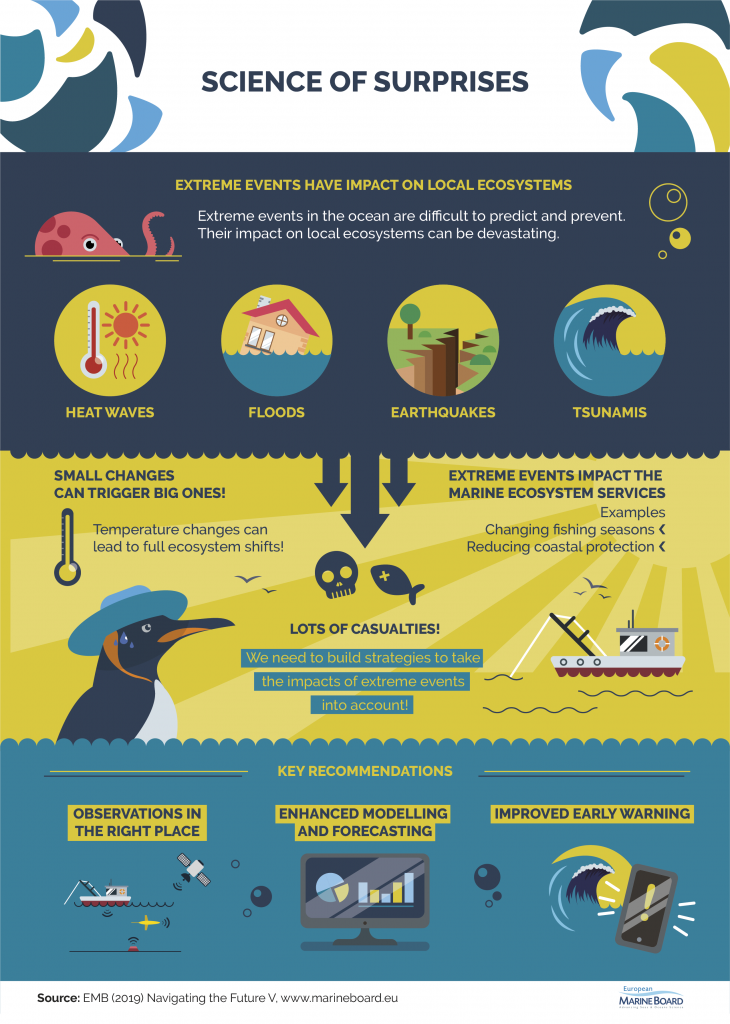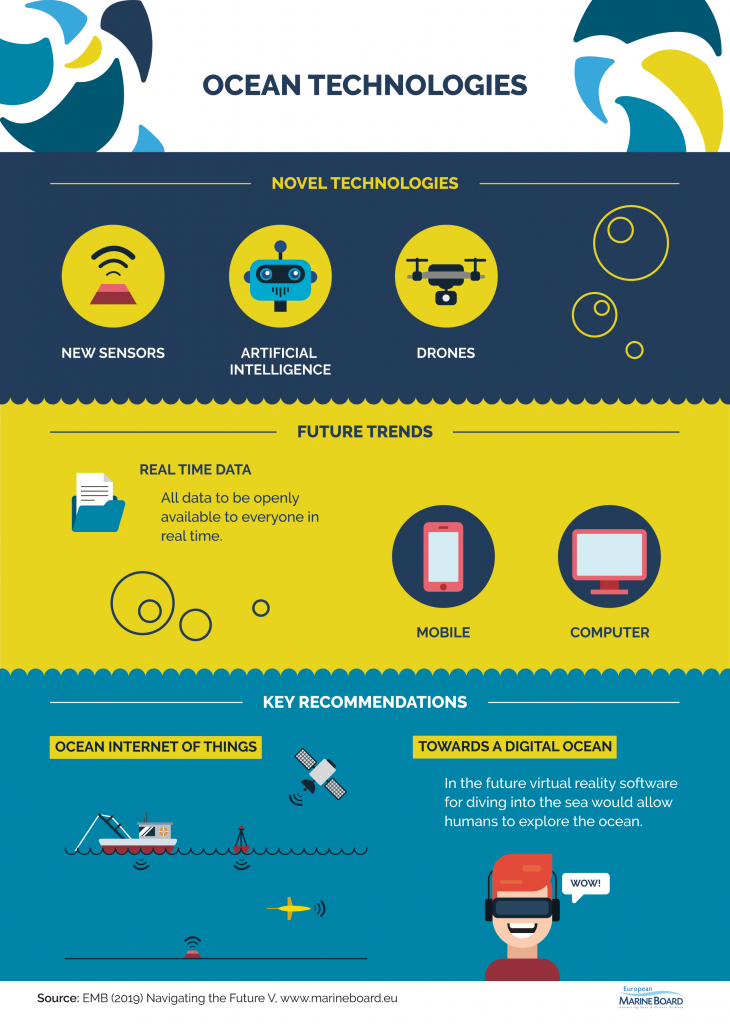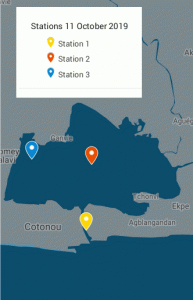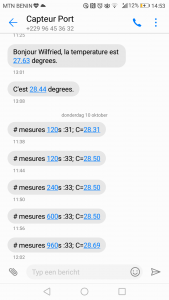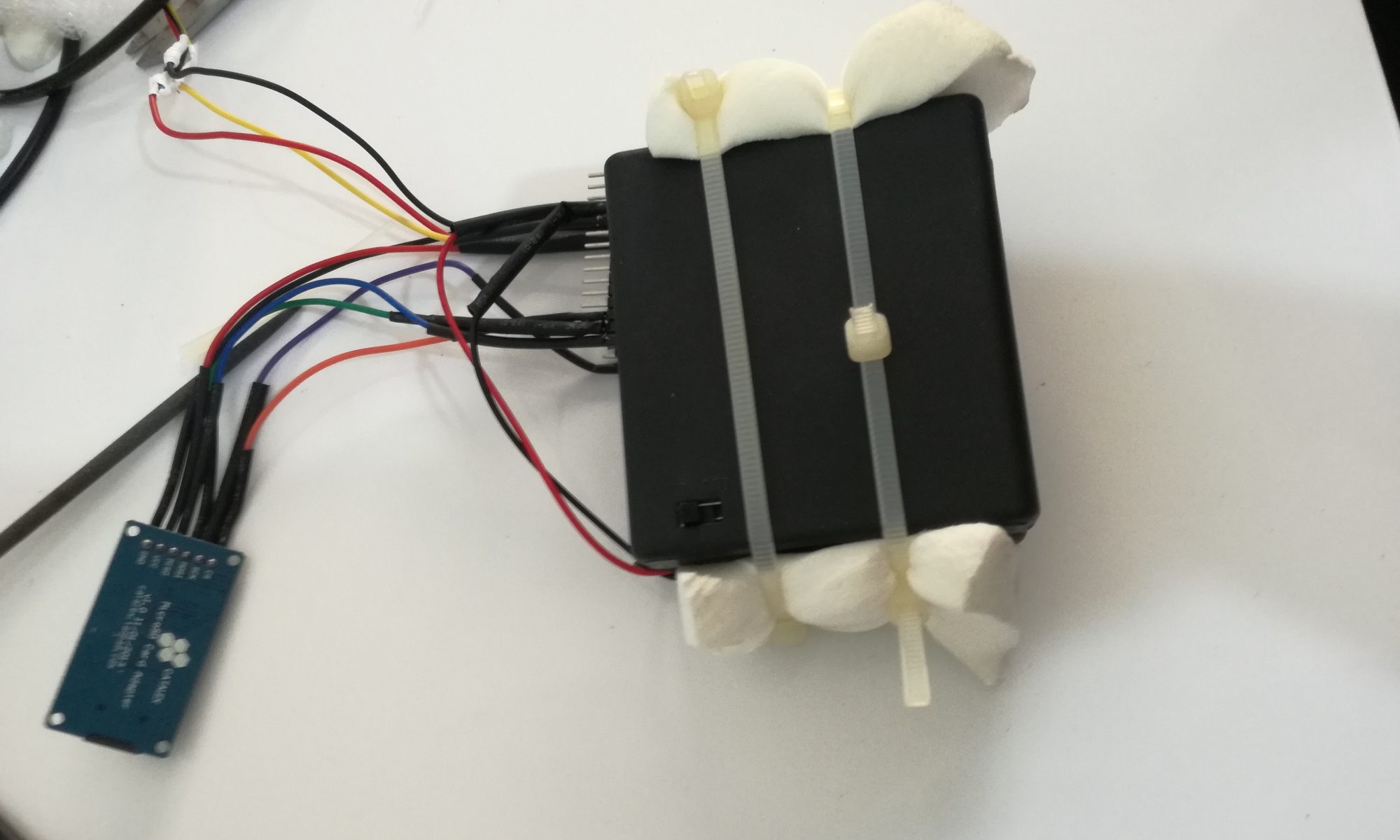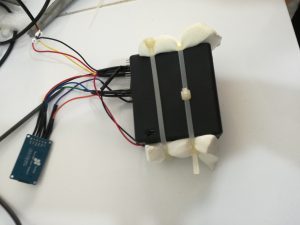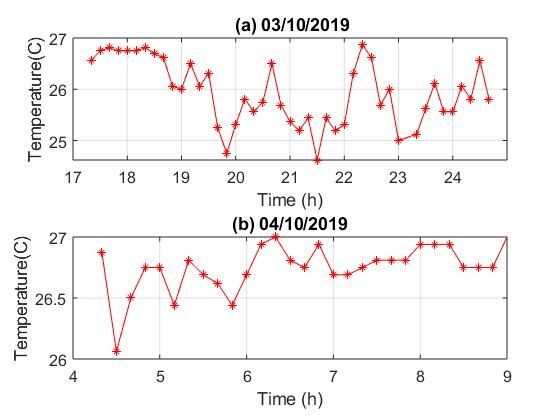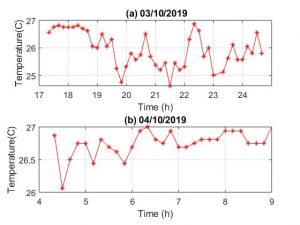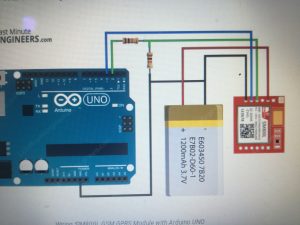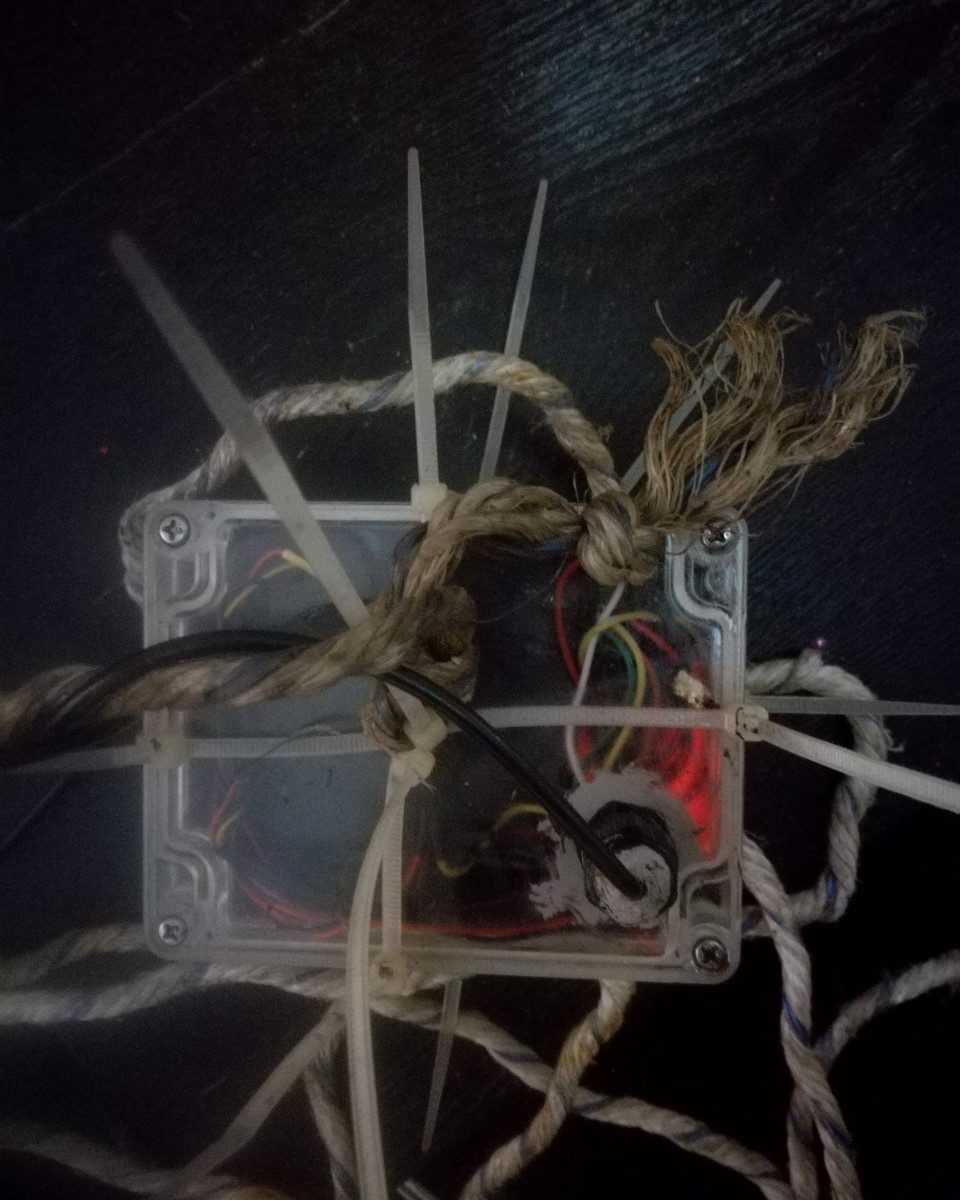Le vendredi 11 octobre, les pays de la mer du Nord ont célébré le 50e anniversaire de leur collaboration à Bonn (Allemagne). Dans le cadre de l’Accord de Bonn, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Danemark, l’Irlande, la Suède et la Norvège luttent ensemble avec l’UE contre la pollution de la mer du Nord. Cet accord régional a vu le jour pour lutter contre la pollution de la mer du Nord par les navires et autres activités maritimes. La Belgique a pris l’initiative d’étendre le champ d’application de l’accord à la prévention de la pollution atmosphérique illicite par les navires.

Évolution de l’accord
En 1967, le pétrolier » Torrey Canyon » perd 117.000 tonnes de pétrole après un naufrage. Peu après cette première marée noire majeure, en 1969, les pays riverains de la mer du Nord ont uni leurs forces et conclu l’Accord de Bonn. Ils s’entraident ainsi dans la lutte contre la pollution causée par les catastrophes en mer, la pollution chronique par les navires et les installations offshore. De plus, ils travaillent ensemble dans l’exercice de la supervision et du contrôle.
La pollution pétrolière en mer du Nord a fortement diminué au fil des ans, principalement en raison du fait qu’aujourd’hui, les rejets illégaux d’hydrocarbures en mer sont rares. C’est le résultat de trente années d’efforts coordonnés dans le cadre de l’accord pour détecter les rejets illégaux et poursuivre les pollueurs pris sur le fait. Cependant, il est toujours important de pouvoir agir rapidement et collectivement en cas de catastrophe environnementale.
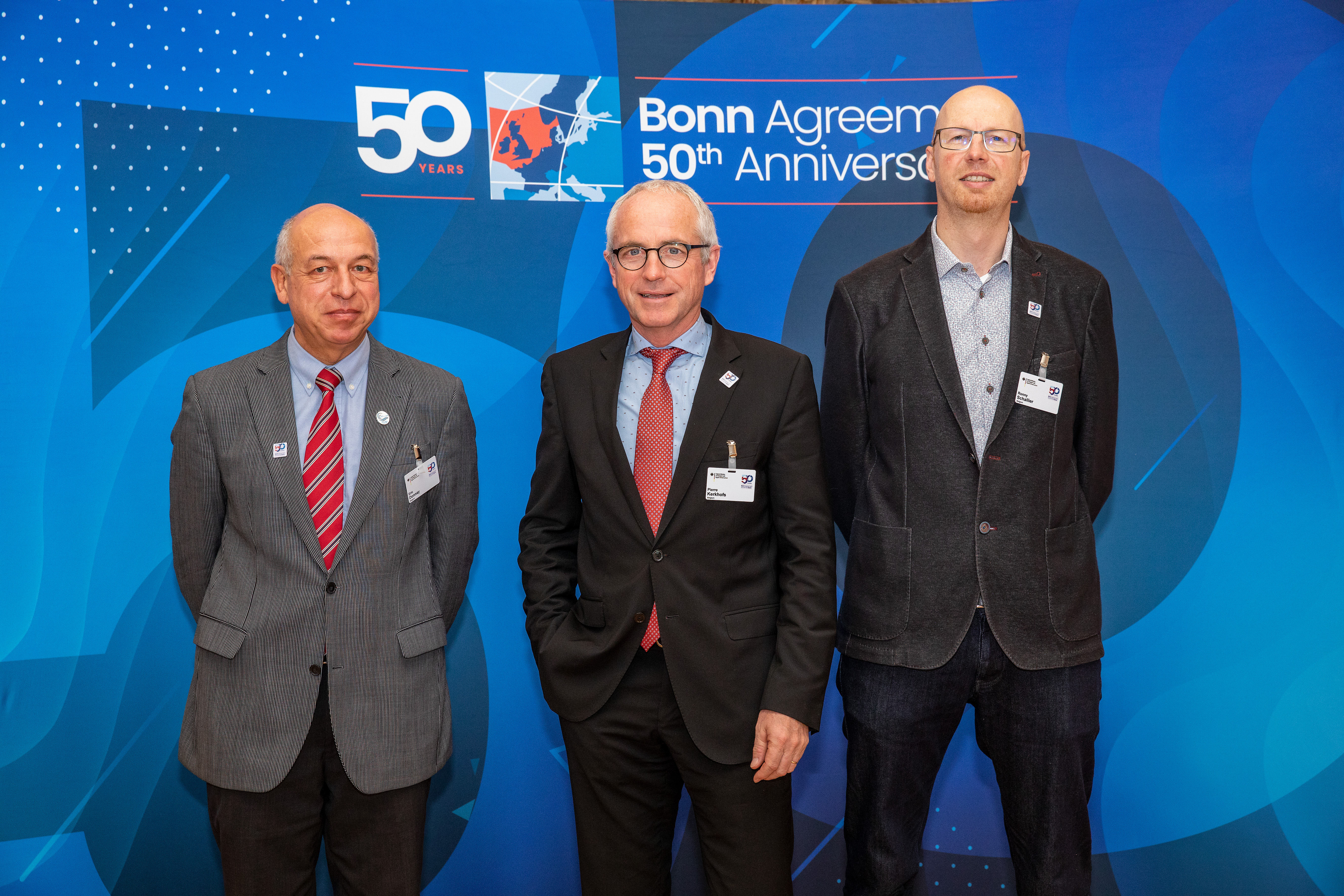
Résultats de la réunion
La réunion de Bonn a pris un certain nombre de décisions importantes pour l’avenir de l’accord, qui ont été adoptées lors d’une réunion ministérielle. Un nouveau plan d’action stratégique ambitieux de l’accord pour les six prochaines années a été finalisé. L’adhésion de l’Espagne à l’accord – qui entraine l’élargissement de la zone de l’accord au golfe de Gascogne – a été officiellement approuvée. Une autre décision importante est l’extension du champ d’application de l’accord aux émissions de gaz polluants provenant des navires. Cela a été fait sur proposition de la Belgique, qui est chargée de l’organisation de ces nouvelles activités.
Philippe De Backer, ministre de la Mer du Nord : « Il s’agit d’une reconnaissance internationale de l’expertise et du rôle pionnier de la Belgique dans la protection des mers et des océans. Il ne fait aucun doute que cette expertise assurera un contrôle encore plus efficace du respect des normes relatives aux émissions de gaz polluants des navires en mer du Nord ».

Mise en œuvre en Belgique
En Belgique, l’Accord de Bonn est mis en œuvre par l’UGMM (Unité de gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord) du IRSNB et le service Milieu marin du SPF Santé publique. Avec la nouvelle action sur le contrôle des émissions des navires, la DG Navigation du SPF Mobilité sera désormais aussi activement impliquée. Ensemble, ils surveillent la pollution marine à l’aide d’avions et de navires de patrouille et effectuent des contrôles à bord des navires dans les ports.
La Belgique est considérée internationalement comme un blue leader dans le domaine de la protection des mers et des océans. Notre pays a été un pionnier en matière de plan d’aménagement des espaces marins, de développement de parcs éoliens offshore et de la lutte contre les déchets plastiques en mer. La Belgique stimule également les mesures internationales qui visent à réduire de moitié les émissions de CO2 des navires d’ici 2050. Les armateurs belges travaillent activement pour parvenir à des navires « zéro-émission ». De plus, un tiers de la partie belge de la mer du Nord est protégé en tant que zone Natura 2000. Le ministre De Backer a récemment confirmé aux Nations-Unies l’ambitieux plan « 30×30 » qui œuvre pour une protection de 30% des océans d’ici 2030. L’initiative d’étendre le champ d’application de l’Accord de Bonn afin de mieux protéger la mer du Nord illustre une fois de plus le rôle pionnier de la Belgique.

Pour plus d’informations : www.bonnagreement.org


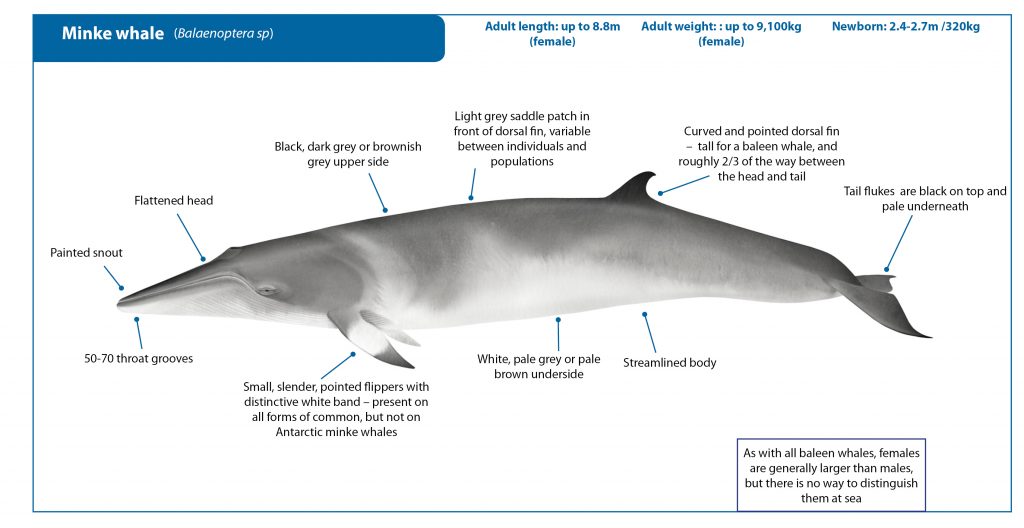


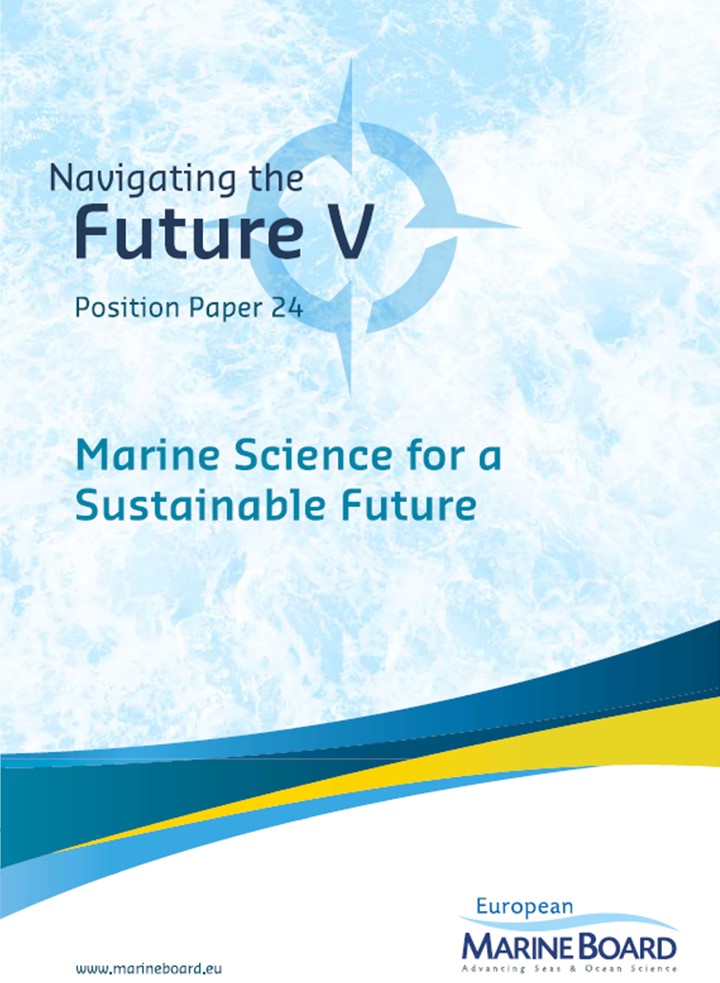
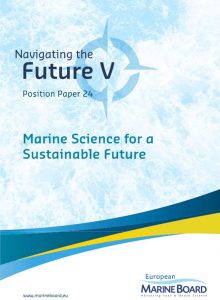 Le Conseil Européen du Milieu Marin (
Le Conseil Européen du Milieu Marin (